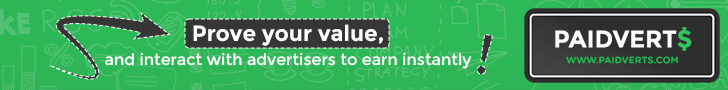C) L'oreille interne.
1) L'oreille interne, un mécanisme complexe.
L'oreille interne est située en arrière de la caisse du tympan.
Elle est constituée par le labyrinthe osseux qui comprend des cavités osseuses en communication les unes avec les autres, ainsi que par le labyrinthe membraneux compsé de canaux ou de cavités à parois membraneuses, contenus dans le labyrinthe osseux.
L'espace qui sépare les labyrinthes porte le nom d'espace périlymphatique, il est en effet rempli d'un liquide appelé périlymphe.
Durant l'étude de l'oreille interne, nous verrons les parties de labyrinthe osseux avec celles du labyrinthe membraneux.
2) Les trois parties de l'oreille interne.
On distingue trois partie dans l'oreille interne :
- Le vestibule
- Les canaux semi-circulaires
- Le limaçon
a) Le vestibule.
Le vestibule osseux est une cavité un peu allongée d'arrière en avant.
Il repond en dehors à la caisse du tympan avec laquelle il communique par la fenêtre ovale.
Le vestibule membraneux se compose de deux vésicules contenues dans le vestibule osseux. La vésicule supérieure est l'utricule, l'autre inférieure est le saccule.
En avant le vestibule osseux se continue avec le limaçon osseux et en arrière avec les cannaux semi-circulaires.
b) Les canaux semi-circulaires.
Les canaux semi-ciculaires sont des tubes cylindriques recourbés en fer à cheval s'ouvrant dans le vestibule par leurs deux extrémités.
Ces canaux n'entrent pas en compte dans la réception des sons mais sont responsables de la faculté d'équilibre, avec le cervelet.
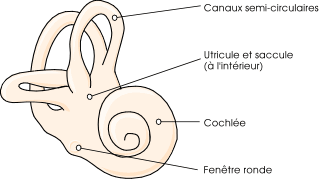
c) Le limaçon, ou cochlée.
Le limaçon, ou cochlée, est situé en avant du vestibule. Il peut être considéré comme formé par un tube cylindrique enroulé autour d'un axe en forme de cône appelé columelle. On pourrait la comparer à un escargot.
L'oreille interne comprend un canal rempli d'endolyphe, la rampe moyenne ou canal cochléaire. Cette partie se détache de la partie antérieure du vestibule, s'enroule autour de la columelle et se termine par une extrémité fermée, la coupole, apex ou encore hélicotrème.
On trouve entre la rampe moyenne et le vestibule un canal étroit appelé canalis reuniens. Comme son nom l'indique, ce canal, fait la réunion des deux parties.
L'oreille interne comprend aussi, solidaire à la rampe moyenne, deux autre compartiment, la rampe vestibulaire et la rampe tympanique toutes deux communiquent avec l'apex du limaçon et sont remplies d'un autre liquide : La périlymphe. La rampe typhanique retourne ver l'oreille moyenne où elle se termie par la fenêtre ronde.
Le limaçon est l'organe résponsable de la réception des sons dans l'oreille interne.
3- La cochlée, un organe de réception



(12)
fig. 1
1 : Tympan
2 : Marteau
3 : Enclume
4 : Étrier
5 : Fenêtre ronde
6 : Fenêtre ovale
7 : Organe d'équilibre
8 : Cochlée
9 : Rampe vestibulaire (à gauche)
10 : Rampe moyenne (au milieu)
11 : Rampe tympanique (à droite)
12 : Vers image suivante
Les ossillations de la membrane de la fenêtre ovale donne naissance dans la cochlée à une "onde propagée", qui va stimuler les cellules sensorielles de l'ouïe. Chaque fréquence sonore est réceptionnée à un niveau différent de la cochlée. C'est par les rampes vestibulaire et tympanique que passent les ondes du son originel.
Les ossillations de la membrane de la fenêtre ovale produisent des ondes de pression de la périlyphe, qui, du fait de son incompréssibilité, provoque une déformation compensatrice de la membrane de la fenêtre ronde (fig 1). Si la membrane de Reissner et la membrane basilaire (fig2 et 5) étaient totalement rigides, ces variations de préssion se propageraient le long de la rampe vestibulaire jusqu'à l'hélicotrème et en retour le long de la rampe tympanique jusqu'à la fenêtre ronde. On n'entendrait donc rien. Mais les parois du canal endolymphatique n'étant jamais rigides, elles cedent aux variations oscilatoire de volume créées par les ondes propagées (fig 3 et 4). De ce fait, les ondes peuvent être court-circuitées et d'ateindre la fenêtre ronde sans avoir besoin de passer par l'hélicotrème.
La paroi du canal endolyphatique cède de façon ondulatoire, c'est à dire que la membrane de Reissner et la membrane basilaire oscillent tantôt vers la rampe vestibulaire tantôt vers la rampe tympanique. (fig. 4 et 5)
La longueur d'onde de l'onde propagée devient de plus en plus courte tandis que son amplitude croit jusqu'à un maximum appelé "enveloppe" (fig. 3) pour se résorber très vite par la suite. La déformation maximale du canal endolymphatique se situe donc d'autant plus près de l'étrier que la longueur d'onde initiale du son est plus courte, c'est à dire un son aigu (fig. 4). Chaque fréquence sonore est ainsi destinée à un endroit précis du canal endolymphatique selon le maximum d'amplitude de l'onde propagée : les fréquences élevées près de la fenêtre ovale et les basses fréquences près de l'hélicotrème.
Les oscilation à l'intérieur du canal endolymphatique entraînent un déplacement de la membrane tectoriale par rapport à la membrane basilaire dans laquelle se trouvent incluse les cellules ciliées, récepteurs de l'organe auditif. Chaque cellule ciliée comprend environ 100 stéréo-cils qui sont en contact étroit avec la membrane tectoriale (fig 1 et 5). Le déplacement relatif des deux membranes l'une par rapport à l'autre produit une courbure des cils ; c'est le stimulus adéquat qui, au niveau des cellules ciliées, induit leur exitation par transduction électromagnétique.
Reliées à des fibres nerveuse, les cellules ciliées traduisent les ondes de pressions en message électrique, interprété par la suite par le cerveau.
a) À "grande" échelle.



Ainsi, la vitesse de l'onde propagée, qui est beaucoup moins important que la vitesse du son d'origine qui se déplaçait dans un milieu gazeux, et la longueur d'onde décroissent progressivement à partir de son origine, la fenêtre ovale. (fig 3)
b) Les fréquences dans l'oreille.
c) Des cellules traductrices.
1 : Rampe vestibulaire
2 : Rampe tympanique
3 : Rampe moyenne
4 : Cellules ciliées
5 : Membrane tectoriale
6 : Membrane de Reissner (dans le cercle vert)
7 : Nerfs (en vert)
1 : Cochlée déroulée
2 : Fenêtre ovale
3 : Fenêtre ronde
fig. 2

Fig. 5
fig. 4
Fig. 3

1 : Membrane de Reissner.
2 : Rampe vestibulaire.
3 : Rampe tympanique
4 : Canal endolymphatique
5 : Membrane basilaire
6 : Membrane tectoriale
7 : Cellules cilliées
8 : Membrane basilaire